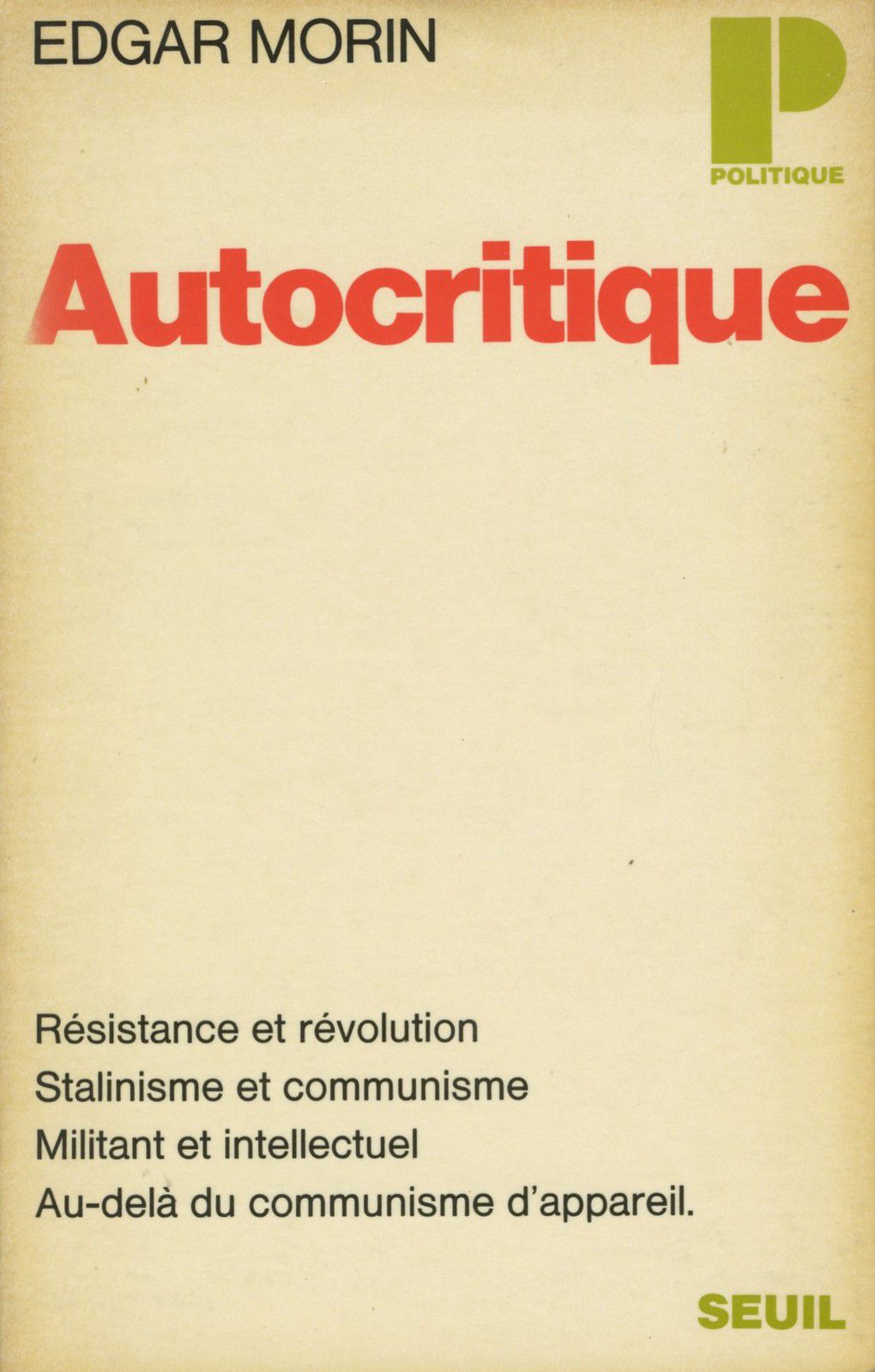Comment a-t-on pu être stalinien ? (3/4)
Edgar MORIN
J'ai lu l'Autocritique d'Edgar MORIN en 1976 je pense, à l'époque où j'émergeai à peine du maoïsme, dans lequel j'ai baigné de 1973 à 1976. Il fut un de mes compagnons intellectuels de désintoxication de cette phase extrémiste et sectaire de mon militantisme.
Je ne l'avais pas relu depuis.
Il faut ajouter que j'avais lu plusieurs livres de Morin entre 16 et 19 ans avant d'entrer en maoïsme : son "Introduction à une politique de l'homme" (1965), son essai "L'homme et la mort " (1951) et ses journaux "Le vif du sujet" (1962) et "Journal de Californie" (1969)... J'avais une sympathie spontanée pour l'homme Morin en raison de sa sincérité et de l'écho que je trouvais chez lui à mon propre mal-être et à ma recherche du sens de la vie. Mais je ne retins pas ce qui chez lui aurait dû m'éloigner de la tentation de l'extrémisme et du sectarisme.
Aujourd'hui, avec le recul du temps, de l'expérience et de la réflexion, j'y trouve bien sûr plus de choses que ce que j'y avais alors puisé. Aussi souhaité-je le faire partager.
Un jeune intellectuel de gauche en recherche
Dans sa préface d'avril 1974, Morin relève ce qui fait encore de son livre un ouvrage d'actualité : "Les grands tropismes qui me poussèrent, parmi tant d'autres, à rompre avec la famille et la société, chercher la vie nouvelle, aller vers le risque et l'aventure, lier l'initiation au monde à l'expérience révolutionnaire, ces tropismes sont plus forts que jamais. Alors, il y a 30 ans, nous étions les marginaux, aujourd'hui le vent de révolte juvénile souffle un peu partout." (p 7)
Cette première raison me parlait tout particulièrement.
Mais, avec le recul, les deux autres raisons m'apparaissent plus importantes.
D'une part, ajoute-t-il, les problèmes fondamentaux de notre monde qu'il résume dans l'expression "âge de fer planétaire" (on y reviendra) restent entiers : "l'Histoire piétine encore là-même où s'arrête ce livre" (ibidem). Je pense qu'une nouvelle préface, en 2020, ajouterait que la prise de conscience des problèmes commence à émerger, mais que les solutions sont loin d'être là.
D'autre part, et ce point reste aussi d'une brûlante actualité, "les germes du stalinisme" restent virulents car "ils précèdent de loin Staline et plongent dans l'archaïsme de la vie mentale et de la vie politique"(ibidem).
Pour toutes ces raisons, suivons la réflexion autocritique d'Edgar Morin avec attention.
En 1940, il a 19 ans, et profite de l'exode de juin pour échapper à la tutelle d'un père trop attentionné (il est veuf et Edgar est son unique enfant) en se réfugiant à Toulouse pour y poursuivre ses études. Edgar Nahoum est alors un pur intellectuel qui a fréquenté à Paris les "minorités de gauche, pacifistes intégraux, libertaires, trotskystes" (p 22). Mais leur attrait est chez lui combattu par le sentiment à la fois "raisonnable" et "craintif" (il insiste beaucoup sur cet aspect de sa personnalité) qui les fait apparaître comme "irréalistes" et "utopiques". Il se tourne donc vers ceux qui insistent sur les "étapes nécessaires", "l'inévitable lenteur", les "possibilités pratiques" et les "données concrètes" nécessaires aux changements souhaités. Paradoxalement, c'est ce "réalisme" qui l'amènera finalement au PCF...
Pour l'heure, il se tourne vers un groupe issu du parti radical-socialiste, et aujourd'hui bien oublié, le parti "frontiste" de Gaston Bergery (pp 22-23). Partie prenante du "Front populaire", ce groupe évoluera ensuite vers la Collaboration...Signe de la confusion des temps ? En réalité, nous dit Morin, les raisonnements subtils basés sur les "ruses de l'Histoire" peuvent amener à des positions paradoxales basées sur de fausses comparaisons. En l'occurrence, on notera que c'est la même façon de penser qui l'amènera successivement à l'abstention face à l'occupation nazie puis à la Résistance au sein du PCF.
Dans un premier temps en effet, il file la comparaison entre Philippe de Macédoine et la conquête d'Athènes, et Hitler et la conquête de l'Europe, avec le calcul paradoxal que l'apparent vainqueur peut être le vrai vaincu sur la longue durée. Et, ajoute-t-il, cette tendance à accepter les "faits accomplis" au nom d'un avenir "radieux" "explique aussi bien mon état d'esprit (attentiste) de 1940 que mon obstination à demeurer au parti communiste après 1947"(p 32)
Etudiant à Toulouse, entouré de résistants, il oppose son scepticisme à ceux qui veulent l'entraîner dans l'action.
En juin 1941, l'invasion de l'URSS constitue un tournant... accentué par l'entrée en guerre des USA en décembre.
Et il subit alors l'attrait irrésistible du stalinisme. Alors qu'il a tout lu sur l'ignominie des procès de Moscou de 1936-37, il recourt encore à l'Histoire et à ses comparaisons hasardeuses : "c'est la menace allemande qui avait contraint Staline à imposer son unité de fer, son commandement de guerre, comme c'était la menace extérieure qui avait amené Robespierre à liquider Hébert (auquel j'assimilais Trotsky) et Danton (auquel j'assimilais Boukharine)." (p 37)
(NB : On sait aujourd'hui que, dans l'un comme dans l'autre cas, la "menace extérieure" n'y est pour rien...)
C'est cependant avec ce genre de justification qu'il franchit le pas de l'adhésion. Mais une raison plus profonde (et plus juste) l'accompagne : le sentiment de devoir communier avec la jeunesse du monde dans l'aventure du siècle, le grand combat contre le fascisme, en dépassant sa peur et en affrontant le risque de mort.
L'aventure de la Résistance
"Un jour, au début de l'année 42, acculé, je dis :"Bon".
Le rendez-vous fut pris pour l'après-dîner. Il (son camarade Dreyfus qui le sollicite d'adhérer au Parti depuis l'automne 39...) vint avec une serviette bourrée de tracts.Il remplissait les boîtes à lettres, dans les petites rues de Toulouse. Je faisais d'abord le guet, sursautant au moindre bruit. Puis je m'enhardis un peu et je glissais les Huma à travers les fentes.
-
Ce que j'ai eu peur.
-
Moi aussi, me dit-il, réjoui.
Il m'arracha quelques autres distributions.Puis il m'annonça triomphalement une soirée de peinture au pochoir sur des murs d'usine." (p 39)
Cette adhésion nouvelle s'accompagne de restrictions mentales : "les thèmes cocardiers et anti-allemands de la presse du parti ne m'attiraient nullement. Ils ne devaient attirer aucun des néophytes que j'ai connus à l'époque. Merveille : on était attirés, non par les justifications officielles du parti, mais pour des raisons souterraines, pour la vieille idée de la révolution mondiale, pour le nouveau mythe du salut par l'efficacité historique.
(...) Et cette exaltation se coulait dans un système qui expliquait le stalinisme comme stade militaire et obsidional de la révolution mondiale, stade qui serait dépassé sitôt brisé l'encerclement capitaliste..." (pp 41-2)
11 novembre 1942 : la zone Sud, donc Toulouse, est occupée par les Allemands. Edgar Morin est invité à Lyon par un ancien condisciple, devenu lui aussi communiste stalinien.
C'est là qu'il devient, de façon impromptue, un "permanent" de l'un des appendices du parti, auquel il a fini par adhérer, après bien des hésitations, le MRPGD, Mouvement de Résistance des Prisonniers de Guerre et Déportés. Il entre donc dans la clandestinité sous une fausse identité, et s'installe à Grenoble. C'est là qu'il échappe pour la première fois à l'arrestation : tout son réseau est tombé, et il reste seul avec sa fiancée et deux camarades. Il décide de repartir à Toulouse pour renouer des contacts.
Il y devient "responsable régional" et loge à Pechbonnieu , dans la banlieue, chez un ménage ouvrier, jusqu'au début de 1944, où il remonte à Paris.
Il est chargé en août de "rédiger le tract pour appeler au soulèvement. Dans mes tracts, j'avais toujours évité le mot "boche" et le mot "allemand"; je disais "nazi". Ce jour-là je me souvins de la sentence qui terminait chaque communiqué soviétique, et où l'adjectif "allemand" était justifié – pensais-je – par le substantif "envahisseur". Je fis composer en caractères gras, pour conclure l'appel aux armes : "Mort aux envahisseurs allemands." (p 62)
L'optimisme manipulé de la Libération
"L'ère terrifiante du stalinisme semblait révolue à jamais. Katyn était un crime allemand. J'en fus irréfutablement convaincu en compulsant un énorme dossier que m'avait fourni l'ambassade soviétique pour l'exposition des "Crimes hitlériens". Les témoignages de centaines de paysans russes concordaient. A cette époque, je fanfaronnais auprès de mes amis : "Si Katyn était l'oeuvre des Russes, je quitterais le parti." "(p 64)
On sait aujourd'hui avec une certitude absolue que ce massacre de milliers d'officiers polonais fut exécuté par le NKVD sur ordre de Staline au printemps 1940, mais il aura fallu pour cela une recherche opiniâtre dans les archives de la commission d'historiens polono-soviétique mise en place par Gorbatchev après 1985 https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Katy%C5%84#La_d%C3%A9couverte_des_archives_sovi%C3%A9tiques
Edgar Morin n'a cependant pas attendu cela pour quitter le parti....
Les intellectuels et le Parti en 1947-48
Intellectuel lui-même, Morin analyse le cas de ceux qui dominent alors la scène intellectuelle et qui furent ou seront des "compagnons de route".
"Sartre proposa la notion d'engagement. La fortune de ce terme vint de son adéquation parfaite à la nouvelle psychologie des intellectuels aux prises avec le problème communiste (...) La notion d'engagement relevait de la psychologie militaire. Or, le stalinisme intellectuel était effectivement une psychose militaire transférée dans la vie civile : tous les problèmes étaient posés en termes d'obéissance et d'efficacité." (pp 81-2)
Sartre et ceux qui le suivent, intellectuels libertaires, sont rétifs à l'obéissance, mais ils sont obsédés par l'efficacité. C'est ce qui va les amener progressivement à se rapprocher du Parti, malgré leurs réticences. Ceci au moment-même où ceux qui les avaient précédés dans cette voie en allant jusqu'au bout, comme Morin et ses amis, suivent la voie de la désobéissance à travers une expérience existentielle du dégoût moral : "par contre les "existentialistes" continuèrent à vivre en-dehors de l'existence réelle, de l'expérience réelle (du stalinisme), ce qui les conduisit , à la veille du rapport Khrouchtchev, aux propylées (porche monumental du temple sacré, l'image est bien choisie) du stalinisme." (p 83)
Camus lui, choisit la morale contre l'efficacité : il refusait la politique au nom de la morale, alors que "nous engloutissions la morale dans la politique" (ibidem). Sa posture lui apparaît, rétrospectivement, plus progressive que régressive.
Mais à l'époque, ces refus de l'alignement total semblaient aux intellectuels staliniens des "faiblesses" relevant d'une forme de "désertion".
Cependant, ceux qui entourent Morin (le "groupe de la rue Saint-Benoît"; où ils habitent en communauté, composé de Robert Antelme, Marguerite Duras, Dionys Mascolo et Violette Morin, l'épouse d'Edgar, qu'il a rencontrée à Toulouse) vont exercer une "résistance culturelle" à l'abaissement stalinien... avec la restriction que ces "problèmes culturels (...) s'interposaient comme un prisme devant les problèmes de fond" (p 84).
Cette "résistance" s'exerce contre ce que Morin baptise les "aragonnades" : à savoir les prises de position d'Aragon, maître absolu du monde de la culture du PCF à l'époque, par la grâce de "Maurice", et régent de la vie intellectuelle à travers sa présidence du CNE (Centre National des Ecrivains). "L'injure ou le mutisme devenaient les armes essentielles de l'action culturelle" vis-à-vis de tous les créateurs indépendants (p 86). "Par contre, semblait-il, le talent le plus exquis authentifiait toute oeuvre d'édification stalinienne" (p 85).
Résistance culturelle et accoutumance
Morin ne suit pas cette ligne et se permet quelques écarts dans les articles qu'il donne pour la presse liée au Parti. Ainsi à l'occasion du prix Nobel de Gide, il tient à signaler dans "Action" que ce "vieux fasciste pédéraste" selon les termes choisis par Jean Kanapa dans "Les Lettres françaises" a eu "une immense influence libératrice" (p 88).
Il se voit rappelé vertement à l'ordre par les jeunes intellectuels dans la ligne. Le verrouillage intellectuel se met en place.
Mais une dernière escarmouche permet au groupe "critique" de remporter une brève victoire. C'est à l'occasion de la mise en place du "Cercle des critiques" du Parti sous la houlette de Laurent Casanova. Le groupe dont Morin fait partie mène l'offensive contre le censeur en chef, Jean Kanapa en revendiquant, dans une lettre collective qu'ils font signer à un maximum de créateurs du Parti, une liberté de création en termes diplomatiquement choisis. Cet appel ne voit finalement pas le jour, et le groupe se disloque à l'été 48, suite à des pressions "d'en haut" et au schisme titiste qui occupe alors les esprits. (p 93-4)
Durant les années 1948 à 1951, cette timide résistance culturelle s'étiole : "Mille petites résignations successives préparent la grande abdication. Le poids de l'intimidation quasi-religieuse faisait pénétrer au plus intime des consciences le Sur-Moi du parti." (p 95)
La seconde glaciation stalinienne (1948-51)
Elle a été amplement décrite par Leroy-Ladurie et Desanti. Morin y ajoute quelques analyses critiques concernant le "concept-ogre d'anticommunisme" et la spécificité du "carriérisme stalinien", ainsi que quelques considérations sur les faiblesses des "sympathisants".
Concernant le premier, il a l'intérêt d'entretenir une indignation permanente : "Ah ! les salauds" était devenu la réponse quotidienne à tout et à rien, le mot de passe, l'alpha et l'oméga" face à un monde extérieur (au parti) suscitant "le dégoût et le mépris" car vécu comme essentiellement hostile et menaçant. Son revers est l'euphorie permanente entretenue par le sentiment de victoires permanentes du camp du Bien et de la Vérité (p 100).
Quant au "carriérisme" au sein du parti, il ne peut s'assimiler au carriérisme bourgeois, car son "élan premier était de don, non de prise" (p 103). Mais, plus ou moins rapidement selon les tempéraments individuels, l'intellectuel de Parti cède à la tentation du confort, car "le parti offrait un public immense à ceux qui écrivaient dans la Norme." (ibidem)
De plus, la nouvelle génération post-Résistance d'intellectuels adhérents a une faiblesse par rapport à la génération précédente : son sentiment de culpabilité de "privilégié" n'est pas amoindri par la prise de risque vital qu'a été la participation à la Résistance.
D'où une volonté renforcée de "donner des gages" et un complexe d'infériorité par rapport au Parti qui s'exerce d'ailleurs encore plus chez les sympathisants, comme les "sartriens" ou les "chrétiens progressistes". Et donc, non seulement une grande timidité dans la critique, mais aussi une grande agressivité vis-à-vis de tous ceux qui se posent comme antistaliniens.
L'exclusion comme libération
Morin et ses amis Antelme et Mascolo sont paradoxalement paralysés par le caractère moral et non politique de leur opposition. Ils trouvent "conne" l'exclusion de Tito, mais ne prennent pas publiquement parti en sa faveur, comme Jean Cassou, Jean Duvignaud et Clara Malraux, qui sont et restent leurs amis. (p 119).
Pareillement, ils vivent le procès Rajk en 1949 sur le mode de l'indignation morale, mais avec un effet décisif pour Morin : "Le stalinisme m'était jusque-là apparu comme une sorte de phénomène naturel, quelque chose comme le fleuve inexorable de l'Histoire. Le procès Rajk m'imposa le sentiment d'un délire.(...)
Le procès Rajk fut la grande rupture, non pas à la surface, mais dans les soubassements de ma croyance. Pour la première fois je refusai la loi de Hegel qui fait de l'Histoire mondiale le tribunal suprême.(...) Au moment du procès, je doutai enfin de cette conscience supérieure, tout en doutant affreusement de ma propre conscience, d'où ma paralysie." (p 125)
Cette paralysie va poursuivre Morin deux ans encore : il n'est plus le croyant qu'il fut, mais il n'ose quitter le parti.
C'est qu'il reste prisonnier de la "psychologie de guerre en temps de paix" entretenue par l'appareil stalinien (p 136).
Il se reproche a postériori d'avoir privilégié la dialectique historique sur l'étude des faits : "Il aurait suffi (...) que je confronte sérieusement ma conception avec les faits qu'elle prétendait expliquer : si j'avais examiné l'histoire de l'URSS avec quelque attention critique, jamais je n'aurais pu fonder le stalinisme en Raison." (p 125-6)
Petite citation complémentaire sur la nécessité d'étudier l'Histoire sérieusement :
"Et où sont aujourd'hui ceux à qui les actions, les factions et les choses monstrueuses de ce temps-là sont connues sinon à fort peu, et dans peu de temps à nul ?" (Agrippa d'Aubigné, "Aux lecteurs", 1616, édition GF des "Tragiques", 1968, p 36). A quoi il ajoutait (déjà !) : "Qui prendra après nous la peine de lire les rares histoires de notre siècle, opprimées, éteintes et étouffées par celles des charlatans gagés ?"
Mais pour l'heure, il reste enfermé dans cette prison mentale de l'hégéliano-marxisme propre à sa génération intellectuelle : "Nombreux étaient ceux de mon âge mental qui, après la faillite des grandes espérances, le triomphe du nazisme, la guerre d'Espagne, l'échec du Front populaire, la guerre mondiale, avaient conclu qu'il fallait ajuster leurs rêves à la réalité.(...) Obéir à l'Histoire pour la transformer.
(...) L'empreinte de Hegel et Marx fut si forte sur nous (...) (qu') à leur suite, pendant des années, nous avons flétri les illusions et les boursouflures de la subjectivité.(...)
Aussi lorsque le procès Rajk nous frappa de plein fouet, toute révolte nous semblait depuis longtemps frivolité impatiente, toute opposition utopie." (p 143-4)
Cette sacralisation de la Raison historique s'accompagne d'une croyance au lien "ontologique" entre le parti et la classe ouvrière, agent de la Raison dans l'Histoire. D'où le dilemme insoluble : combattre le stalinisme, ce serait combattre la classe ouvrière, donc aller contre la Raison historique. (p 147)
Devenu un "émigré de l'intérieur" (p 162), Morin n'est plus employé par le parti : il a une indépendance économique grâce à son entrée au CNRS due à Georges Friedmann. Mais, bien que ne fréquentant plus les réunions de cellule, il reste formellement membre du parti.
C'est la parution d'un article signé par lui dans "L'Observateur", journal de Claude Bourdet, l'un des futurs fondateurs du PSU en 1960, à la demande de Gilles Martinet, qui provoque sa procédure d'exclusion. L'article en lui-même n'était qu'un compte-rendu d'un colloque sociologique sur "Villes et campagnes" sans prise de position politque.
Oui mais voilà : l'Observateur n'appartenant pas à la mouvance du parti est forcément alors un organe ennemi. Claude Bourdet étant considéré comme un agent de l'Intelligence Service britannique...ainsi que le lui fait savoir la nouvelle responsable des intellectuels de la Fédération de la Seine, Annie Besse (devenue depuis Annie Kriegel).
Convoqué à une réunion de sa cellule, Morin est exclu à l'unanimité. C'est pour lui, paradoxalement encore, une surprise et un traumatisme. Mais huit jours plus tard, un sentiment positif inédit l'envahit : il est désormais libre de s'exprimer comme il veut. Il "perdi(t) de faux camarades et n'eu(t) pas à changer d'amis." (p 171)
Avatar du stalinisme : le soutien au FLN
Devenu un communiste sans parti, Morin peut librement s'engager dans les causes qu'il choisit. Ainsi, il crée avec ses amis Antelme, Mascolo et Louis-René des Forêts à l'automne 1955 le Comité d'action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Algérie.
Bientôt rejoint par de nombreux intellectuels de gauche, dont "quelques communistes déçus par la mollesse tacticienne du parti" (NB celui-ci vote les pleins pouvoirs à Guy Mollet en février 56 pour "rétablir l'ordre en Algérie"), ce comité est bientôt le théâtre d'une anathémisation du MNA de Messali Hadj par les partisans inconditionnels du FLN. A cette occasion, Morin voit avec horreur se reproduire ce qu'il a connu au parti : il est, dit-il, frappé d'anaphylaxie (p 188). Mon dictionnaire me dit que l'anaphylaxie est une "augmentation de la sensibilité de l'organisme à l'égard d'une substance déterminée, par la pénétration préalable dans le corps d'une dose, même minime de cette substance." En l'occurrence la substance est l'intolérance paranoïaque, que Morin ressent plus vivement que jamais : "cette fois ma violent allergie à la pensée policière vérifiait – et déterminait - la profondeur de ma désintoxication." (p 190)
Cet affrontement, qui se redouble d'un affrontement sur le recours ou non à la Commission Rousset d'enquête sur les camps (les sartriens, progressistes et staliniens sont contre, et même ses propres amis, car Rousset "fait le jeu du camp américain" pour s'être intéressé aux camps soviétiques), voit Morin isolé "mais cette solitude combattante était plus tonique que ma solitude hébétée d'antan." (p 191)
On est dans les mois précédant le rapport Khrouchtchev : "Un bolchévisme d'arrière-saison se répandait sur Saint-Germain-des-Prés (...) Ces intellectuels voulaient montrer aux staliniens qu'ils étaient "avec eux". On parlait du parti avec un P majuscule. Le trotskysme faisait horreur.(...) J'étais l' "anticommuniste" aigri." (ibidem).
La déstalinisation profonde
Bien entendu, comme pour Leroy-Ladurie et Desanti, l'année 1956 est décisive pour achever la déconstruction du mythe stalinien : du rapport Khrouchtchev aux octobres polonais et hongrois, c'est tout l'édifice qui s'effondre.
Pour Morin, c'est une reconstruction intellectuelle qui s'amorce. Dans un premier temps, c'est une synthèse nouvelle née de l'expérience des conseils ouvriers de Pologne et de Hongrie : ils renouent avec l'expérience fondatrice des premières révolutions ouvrières , "mais ce socialisme des conseils cherchait désormais à se combiner avec des structures de contrôle : pluralité des partis politiques, séparation des pouvoirs, parlement élu au suffrage universel. Mon idée du socialisme se dissociait enfin de l'appareil d'État (...) Et ainsi s'opérait un prodigieux renversement de perspectives : alors que ma vulgate repoussait le dépérissement de l'État vers un futur eschatologique, je me trouvais maintenant placé sur le terrain immédiat et permanent d'un combat contre le totalitarisme d'État." (p 204)
En cela, il a une longueur d'avance, qu'il gardera longtemps, sur bien d'autres déçus du stalinisme, dont certains vont juste se reconvertir dans de nouveaux mythes révolutionnaires léninistes.
L'âge de fer planétaire
Il ne s'arrête pas là. Car il a bien conscience que de nouveaux enjeux se font jour, ce qui va lui éviter le repli douillet, comme à d'autres, sur la démocratie libérale dans sa version de centre-droit.
Cela passe tout d'abord par la remise en cause de la mission historique du prolétariat : il refuse alors de ne voir dans l'apathie politique ouvrière en France que la "trahison" des directions du PCF ou de la SFIO (p 218). L'expérience du quasi-coup d'État gaulliste du 13 mai 1958 est à cet égard décisive.
Il refuse également la tentation de reporter la mission historique émancipatrice sur les peuples coloniaux, comme le feront certains "tiers-mondistes" qui ont lu trop vite Frantz Fanon.
Mais il voit bien par contre que les problèmes politiques majeurs deviennent à présent planétaires. Et que c'est donc à l'échelle de la planète qu'il faut à présent raisonner.
S'il n'est pas encore écologiste (il le deviendra dès 1972), il voit bien cependant que la technique et le mode de vie consumériste posent des problèmes nouveaux.
Mais les affronter suppose de dépasser "l'âge de fer" que nous vivons : celui des" vieilles puissances de l'histoire (qui) règnent toujours." (p 228)